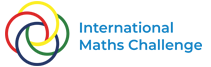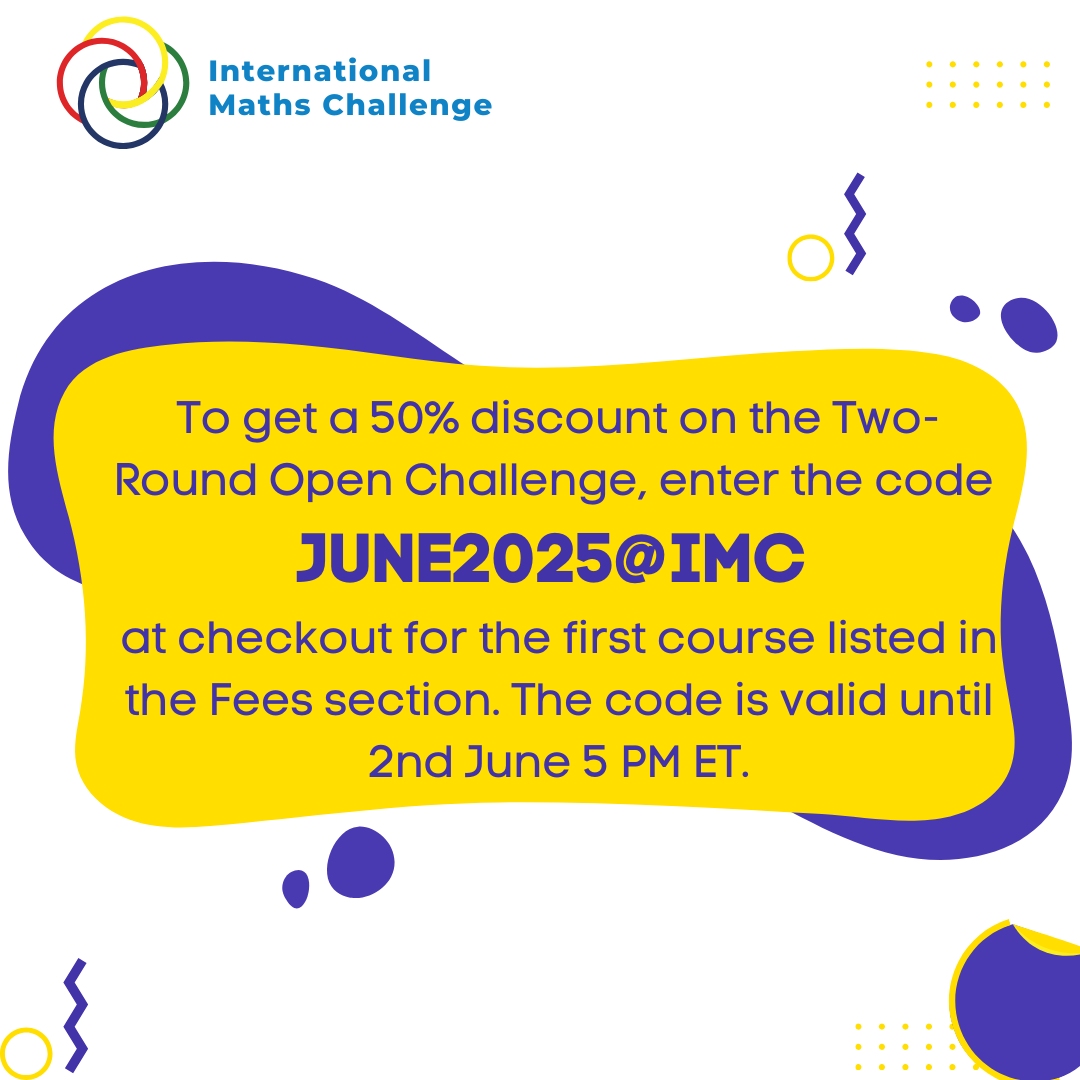Des générations de scientifiques ont comparé l’univers à un jeu géant et complexe, soulevant des questions sur qui y joue – et ce que cela signifierait de gagner.
Si l’univers est un jeu, alors qui y joue ?
Ce qui suit est un extrait de notre newsletter Lost in Space-Time. Chaque mois, nous confions le clavier à un physicien ou un mathématicien pour vous parler d’idées fascinantes de leur coin de l’univers. Vous pouvez vous inscrire gratuitement à Lost in Space-Time ici.
L’univers est-il un jeu ? Le célèbre physicien Richard Feynman le pensait certainement : « “Le monde” ressemble à une grande partie d’échecs jouée par les dieux, et nous sommes les observateurs du jeu. » En observant, notre tâche en tant que scientifiques est d’essayer de comprendre les règles du jeu.
Le mathématicien du XVIIe siècle Gottfried Wilhelm Leibniz considérait aussi l’univers comme un jeu et a même financé la fondation d’une académie à Berlin dédiée à l’étude des jeux : « J’approuve fortement l’étude des jeux de raison non pour eux-mêmes mais parce qu’ils nous aident à perfectionner l’art de penser. »
Notre espèce adore jouer, pas seulement en tant qu’enfants mais jusqu’à l’âge adulte. On pense que cela a été une partie importante du développement évolutif – à tel point que le théoricien culturel Johan Huizinga a proposé qu’on nous appelle Homo ludens, l’espèce qui joue, plutôt qu’Homo sapiens. Certains ont suggéré qu’une fois que nous avons réalisé que l’univers est contrôlé par des règles, nous avons commencé à développer des jeux comme moyen d’expérimenter les conséquences de ces règles.
Prenons, par exemple, l’un des tout premiers jeux de plateau que nous avons créés. Le Jeu royal d’Ur remonte à environ 2500 av. J.-C. et a été trouvé dans la cité sumérienne d’Ur, partie de la Mésopotamie. Des dés tétraédriques sont utilisés pour faire courir cinq pièces appartenant à chaque joueur le long d’une séquence partagée de 12 cases. Une interprétation du jeu est que les 12 cases représentent les 12 constellations du zodiaque qui forment un arrière-plan fixe au ciel nocturne et les cinq pièces correspondent aux cinq planètes visibles que les anciens observaient se déplacer dans le ciel nocturne.
Mais l’univers lui-même peut-il être qualifié de jeu ? Définir ce qui constitue réellement un jeu a fait l’objet d’un débat passionné. Le logicien Ludwig Wittgenstein croyait que les mots ne pouvaient pas être définis par une définition de dictionnaire et ne gagnaient leur sens qu’à travers la façon dont ils étaient utilisés, dans un processus qu’il appelait le « jeu de langage ». Un exemple d’un mot qui, selon lui, ne tirait son sens que de l’usage plutôt que de la définition était « jeu ». Chaque fois que vous essayez de définir le mot « jeu », vous finissez par inclure certaines choses qui ne sont pas des jeux et en exclure d’autres que vous vouliez inclure.
D’autres philosophes ont été moins défaitistes et ont essayé d’identifier les qualités qui définissent un jeu. Tout le monde, y compris Wittgenstein, s’accorde à dire qu’une facette commune de tous les jeux est qu’ils sont définis par des règles. Ces règles contrôlent ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire dans le jeu. C’est pour cette raison que dès que nous avons compris que l’univers est contrôlé par des règles qui limitent son évolution, l’idée de l’univers comme jeu s’est imposée.
Dans son livre L’Homme, le Jeu et les Jeux, le théoricien Roger Caillois a proposé cinq autres traits clés qui définissent un jeu : l’incertitude, l’improductivité, la séparation, l’imagination et la liberté. Alors, comment l’univers correspond-il à ces autres caractéristiques ?
Le rôle de l’incertitude est intéressant. Nous entrons dans un jeu parce qu’il y a une chance que l’un ou l’autre camp gagne – si nous savons à l’avance comment le jeu se terminera, il perd tout son pouvoir. C’est pourquoi assurer une incertitude continue le plus longtemps possible est un composant clé dans la conception de jeux.
Le polymathe Pierre-Simon Laplace a déclaré de façon célèbre que l’identification par Isaac Newton des lois du mouvement avait supprimé toute incertitude du jeu de l’univers : « Nous pouvons considérer l’état présent de l’univers comme l’effet de son passé et la cause de son futur. Une intelligence qui à un certain moment connaîtrait toutes les forces qui mettent la nature en mouvement, et toutes les positions de tous les éléments dont la nature est composée, si cette intelligence était aussi vaste pour soumettre ces données à l’analyse, elle embrasserait dans une seule formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus petit atome ; pour une telle intelligence rien ne serait incertain et l’avenir tout comme le passé pourrait être présent devant ses yeux. »
Les jeux résolus subissent le même sort. Puissance 4 est un jeu résolu dans le sens où nous connaissons maintenant un algorithme qui garantira toujours la victoire au premier joueur. Avec un jeu parfait, il n’y a pas d’incertitude. C’est pourquoi les jeux de pure stratégie souffrent parfois – si un joueur est bien meilleur que son adversaire, alors il y a peu d’incertitude dans le résultat. Donald Trump contre Garry Kasparov dans une partie d’échecs ne sera pas un jeu intéressant.
Les révélations du XXe siècle, cependant, ont réintroduit l’idée d’incertitude dans les règles de l’univers. La physique quantique affirme que le résultat d’une expérience n’est pas prédéterminé par son état actuel. Les pièces du jeu pourraient se diriger dans plusieurs directions différentes selon l’effondrement de la fonction d’onde. Contrairement à ce qu’Albert Einstein croyait, il semble que Dieu joue un jeu avec des dés.
Même si le jeu était déterministe, les mathématiques de la théorie du chaos impliquent aussi que les joueurs et les observateurs ne pourront pas connaître l’état présent du jeu dans tous ses détails et que de petites différences dans l’état actuel peuvent résulter en des résultats très différents.
Qu’un jeu doive être improductif est une qualité intéressante. Si nous jouons à un jeu pour de l’argent ou pour nous apprendre quelque chose, Caillois croyait que le jeu était devenu du travail : un jeu est « une occasion de pure perte : perte de temps, d’énergie, d’ingéniosité, d’habileté ». Malheureusement, à moins que vous ne croyiez en une puissance supérieure, toutes les preuves pointent vers l’absence de but ultime de l’univers. L’univers n’est pas là pour une raison. Il est, tout simplement.
Les trois autres qualités que Caillois décrit s’appliquent peut-être moins à l’univers mais décrivent un jeu comme quelque chose de distinct de l’univers, bien qu’évoluant parallèlement à lui. Un jeu est séparé – il fonctionne en dehors du temps et de l’espace normaux. Un jeu a son propre espace délimité dans lequel il se joue dans une limite de temps définie. Il a son propre commencement et sa propre fin. Un jeu est un temps mort de notre univers. C’est une évasion vers un univers parallèle.
Le fait qu’un jeu doive avoir une fin est aussi intéressant. Il y a le concept d’un jeu infini que le philosophe James P. Carse a introduit dans son livre Jeux finis et infinis. Vous ne cherchez pas à gagner un jeu infini. Gagner termine le jeu et le rend donc fini. Au lieu de cela, le joueur du jeu infini a pour tâche de perpétuer le jeu – s’assurer qu’il ne finisse jamais. Carse conclut son livre avec la déclaration plutôt cryptique : « Il n’y a qu’un seul jeu infini. » On réalise qu’il fait référence au fait que nous sommes tous des joueurs dans le jeu infini qui se déroule autour de nous, le jeu infini qu’est l’univers. Bien que la physique actuelle postule un coup final : la mort thermique de l’univers signifie que cet univers pourrait avoir une fin de partie que nous ne pouvons rien faire pour éviter.
La qualité d’imagination de Caillois fait référence à l’idée que les jeux sont de la fiction. Un jeu consiste à créer une seconde réalité qui fonctionne en parallèle avec la vraie vie. C’est un univers fictif que les joueurs invoquent volontairement indépendamment de la réalité sévère de l’univers physique dont nous faisons partie.
Enfin, Caillois croit qu’un jeu exige la liberté. Quiconque est forcé de jouer à un jeu travaille plutôt qu’il ne joue. Un jeu, par conséquent, se connecte avec un autre aspect important de la conscience humaine : notre libre arbitre.
Cela soulève une question : si l’univers est un jeu, qui y joue et que signifiera gagner ? Ne sommes-nous que des pions dans ce jeu plutôt que des joueurs ? Certains ont spéculé que notre univers est en fait une énorme simulation. Quelqu’un a programmé les règles, saisi des données de départ et a laissé la simulation tourner. C’est pourquoi le Jeu de la vie de John Conway ressemble le plus au type de jeu que l’univers pourrait être. Dans le jeu de Conway, des pixels sur une grille infinie naissent, vivent et meurent selon leur environnement et les règles du jeu. Le succès de Conway a été de créer un ensemble de règles qui a donné naissance à une complexité si intéressante.
Si l’univers est un jeu, alors il semble que nous aussi avons eu de la chance de nous retrouver partie d’un jeu qui a l’équilibre parfait de simplicité et de complexité, de hasard et de stratégie, de drame et de péril pour le rendre intéressant. Même quand nous découvrons les règles du jeu, il promet d’être un match fascinant jusqu’au moment où il atteint sa fin de partie.
Pour plus de telles perspectives, connectez-vous sur www.international-maths-challenge.com.
*Crédit pour l’article donné à Marcus Du Sautoy*